Protestations de la Génération Z au Maroc : entre préoccupations sociales légitimes et risques de manipulation
Les manifestations des 27 et 28 septembre, menées par des jeunes issus de la dite Génération Z dans plusieurs villes marocaines, ont ravivé un débat complexe :
S’agit-il d’une explosion spontanée de frustration sociale, ou d’un mouvement partiellement instrumentalisé depuis l’étranger ?
Une analyse en trois dimensions : sociale, médiatique et éthique.
Les mobilisations récentes ne doivent pas être examinées uniquement sous le prisme du maintien de l’ordre. Elles révèlent en réalité l’existence d’une société active, dotée d’une capacité critique. Le véritable signe d’inquiétude serait plutôt un silence social généralisé. Dans ce contexte, la protestation pacifique – même lorsqu’elle naît sur les réseaux numériques et échappe aux structures traditionnelles – peut être perçue comme une forme de catharsis collective.
Ce nouvel acteur social qu’est la Génération Z marocaine pose des défis sans précédent. Il s’agit de jeunes non affiliés, n’ayant jamais été filtrés par les partis politiques ou les syndicats, et qui s’organisent via des plateformes telles que Discord, Telegram ou Instagram. Leur communication est rapide, émotionnelle et virale. Ils ne cherchent pas de médiateurs classiques, mais des espaces d’expression immédiats.
L’un des phénomènes les plus révélateurs est l’émergence de plateformes comme GENZ212, qui regroupent des milliers de jeunes partageant des préoccupations sociales communes, sans pour autant disposer d’un leadership défini. Ce modèle horizontal donne de la force au mouvement… mais le rend aussi instable et vulnérable à toutes sortes d’influences extérieures.
Du côté le plus critique, des alertes ont été émises concernant des liens suspects entre certains administrateurs du mouvement — localisés hors du Maroc — et des acteurs médiatiques notoirement hostiles à l’État marocain. À cela s’ajoute le virage radical pris par certaines pages, passées en quelques jours de contenus sportifs à des appels à la rupture politique.
Sommes-nous face à un nouveau modèle de citoyenneté numérique, ou à une stratégie soigneusement pensée pour canaliser le mécontentement vers des objectifs plus sombres ?
Bien qu’il existe des défaillances structurelles évidentes dans des secteurs comme la santé ou l’éducation — défaillances reconnues même dans les discours de Sa Majesté le Roi —, prétendre que l’argent investi dans la Coupe d’Afrique ou dans la Coupe du Monde 2030 est la cause de tous les maux relève d’une simplification dangereuse.
Peut-on sérieusement s’attendre à ce que la Fédération de football répare les hôpitaux ? C’est absurde. On confond délibérément les priorités et les responsabilités afin d’alimenter un discours de discrédit.
Le danger ici ne réside pas dans la protestation sociale en soi — à laquelle une partie de la population adhère d’ailleurs —, mais dans la manipulation d’une jeunesse sans repères politiques clairs, devenue une cible facile pour des messages extrémistes visant à semer la haine envers son propre pays. Personne ne s’oppose à ce que les jeunes s’expriment, mais il faut faire preuve de lucidité : aucune protestation de cette ampleur n’est totalement innocente ni entièrement spontanée.
Ce n’est ni en niant les acquis, ni en polarisant les débats, qu’un pays se construit. Pour que la critique soit utile, elle doit s’accompagner de propositions réalistes et d’un engagement sincère pour l’intérêt général.
L’un des thèmes les plus récurrents dans ces protestations est l’effondrement du système de santé. Mais pour en avoir une compréhension honnête, il est essentiel de reconnaître que le problème n’est pas seulement structurel, il est aussi éthique.
Une partie importante des médecins du secteur public travaille en parallèle dans des cliniques privées, abandonnant — parfois — leurs responsabilités dans les hôpitaux publics. Certains redirigent même directement les patients vers leurs cabinets privés, affaiblissant davantage la confiance dans le service public.
Ce double jeu doit être encadré avec fermeté. Le ministère de la Santé doit assumer son rôle non seulement comme initiateur de réformes, mais aussi comme garant de l’éthique professionnelle. La santé ne peut être considérée comme un marché, et ceux qui ont été formés dans des universités publiques doivent aussi rendre des comptes au système qui les a formés.
Derrière les slogans émotionnels et les hashtags bien conçus, se cachent des stratégies répondant à des agendas précis. Et le plus préoccupant, c’est que ces agendas — dans de nombreux cas — n’ont rien à voir avec la santé, l’éducation ou même la Palestine, mais visent un objectif plus pernicieux : déstabiliser un pays en pleine ascension régionale.
Le Maroc est face à une génération qui ne ressemble à aucune autre : hyperconnectée, critique, impatiente, désillusionnée par les canaux classiques. Mais cela ne fait pas d’elle une ennemie de l’État, bien au contraire : elle est une composante essentielle de son avenir.
Ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement l’ordre social, mais la légitimité des institutions face à un nouveau langage citoyen. Répondre avec intelligence, autocritique et propositions concrètes est la meilleure garantie de stabilité. Un pays qui sait écouter sa jeunesse est un pays qui se prépare à durer.


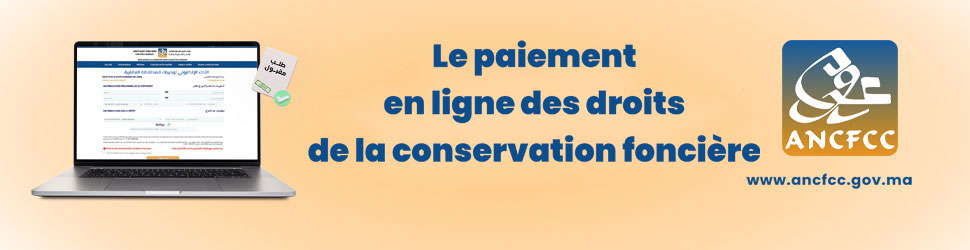
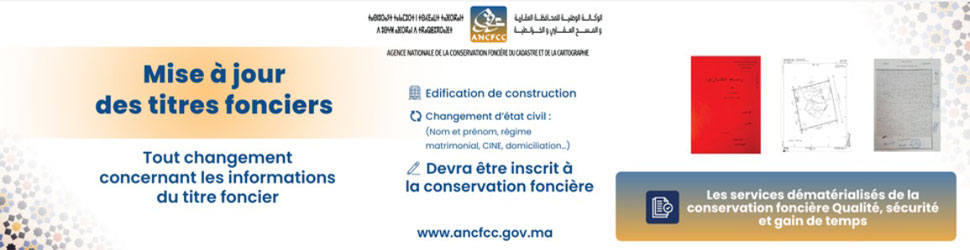



Les commentaires sont fermés.