4e Conférence des diplomaties féministes à Paris: Sous l’impulsion de SM le Roi, le Maroc a engagé “une marche irréversible” vers l’égalité femmes-Hommes (Nasser Bourita)
Depuis 25 ans, sous l’impulsion de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, le Royaume du Maroc a engagé “une marche irréversible” vers l’égalité femmes-hommes, avec des réformes constitutionnelles, législatives et institutionnelles, a souligné, mercredi à Paris, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.
Ces réformes ont non seulement modifié la lettre du droit mais également changé l’esprit d’une génération : celui d’une société qui reconnaît dans l’équité, le fondement de sa modernité, a poursuivi M. Bourita, qui s’exprimait à l’ouverture de la 4e Conférence des diplomaties féministes, en présence de chefs de diplomatie d’une cinquantaine de pays, dont Jean Noël Barrot, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères et José Manuel Albares, ministre espagnol des Affaires étrangères.
Le ministre a rappelé l’adhésion du Royaume au Groupe de politique étrangère féministe (FFP+), notant qu’en rejoignant ce groupe, le Maroc “adhère à une ambition : celle d’agir de concert avec des pays qui partagent ces mêmes valeurs et en font un axe assumé de leurs diplomaties”.
“Notre sérénité tient au choix fait par SM le Roi Mohammed VI d’ériger les droits des femmes et l’égalité en priorités de Son Règne”, a indiqué le ministre.
Il a, en outre, souligné que la transformation du Royaume – d’abord intérieure – “a naturellement trouvé son prolongement dans notre action extérieure”, notant que le Maroc a mis l’égalité au cœur de sa diplomatie.
“Notre diplomatie féministe est d’abord une diplomatie au service de la paix”, a soutenu M. Bourita, rappelant qu’en mars 2022, le Maroc a adopté son premier Plan d’action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité.
“Nous venons de le prolonger jusqu’en 2026, afin de consolider ses acquis et de placer davantage les femmes au cœur des efforts de prévention, de médiation et de reconstruction”, a-t-il enchaîné.
Le ministre a également rappelé que le Maroc est le neuvième contributeur mondial aux opérations de maintien de la paix, précisant que “sur 3.400 de nos casques bleus déployés, 120 sont femmes. Et nous continuerons à renforcer leur présence dans nos contingents et nos états-majors”.
M. Bourita a, dans ce sillage, indiqué qu’au-delà du maintien de la paix, le Royaume agit aussi proactivement pour sa consolidation.
“Nous formons des médiatrices – ces femmes de terrain, qui incarnent une diplomatie de proximité. Elles désamorcent les tensions au sein des communautés, restaurent la confiance, recréent du lien. Les autonomiser, c’est donner à la paix un visage humain”, a-t-il fait observer.
Dans le même esprit, “nous formons des observateurs électoraux, en partenariat avec l’Union africaine”, a noté le ministre, ajoutant qu’entre 2022 et 2025, le Maroc a formé plusieurs observateurs africains, parmi lesquels 175 observatrices, sur un total de 300 lauréats.
La diplomatie féministe du Royaume, a-t-il souligné, s’exprime aussi dans la sphère religieuse – “levier essentiel de stabilité et de paix”, expliquant que “les morchidates – ces femmes prédicatrices formées au Maroc – sont aujourd’hui des vecteurs puissants de prévention de l’extrémisme violent”.
“Notre engagement s’exprime, en outre, dans notre politique migratoire. Les femmes représentent près de la moitié des immigrés réguliers au Maroc, et nos deux campagnes de régularisation, en 2014 et 2017, leur ont offert protection et dignité. C’est une autre facette de cette diplomatie féministe : celle qui refuse l’exclusion”, a dit le ministre.
Au Conseil des Droits de l’Homme à Genève, a-t-il rappelé, le Maroc a porté, en avril, une résolution historique sur : “Femmes, diplomatie et droits de l’Homme”, notant que ce texte renforce l’institution de la “Journée internationale des femmes en diplomatie”, inscrit à l’agenda international la question de la sous-représentation des femmes dans la diplomatie, et appelle les États à leur garantir un accès égal aux fonctions diplomatiques et à prévenir toute forme de discrimination.
“Notre diplomatie féministe s’exprime, enfin, sur le plan bilatéral. Cette approche se traduit concrètement dans notre dialogue avec la France – où l’égalité est un axe du partenariat d’exception; mais aussi avec l’Espagne – à travers nos consultations politiques régulières”, a-t-il indiqué, soulignant que celle-ci s’exprime également “dans notre coopération avec le Japon, par exemple (autour de l’agenda Femmes, Paix et Sécurité), et s’étend à nos échanges avec les pays d’Amérique latine et nous entendons poursuivre dans cette voie”.
Dans tous les domaines, “l’inclusion des femmes est un facteur d’efficacité collective”, a affirmé le ministre. Dans la paix, d’abord : la participation des femmes aux processus de négociation augmente de 20 % la probabilité qu’un accord tienne au moins deux ans, et de 35 % qu’il perdure quinze ans, a-t-il précisé.
Dans l’économie, “l’inclusion active des femmes dans le travail, l’entrepreneuriat et la gouvernance ne relève pas seulement de l’égalité ; c’est un levier de croissance et de performance. Refermer l’écart de genre pourrait, selon la Banque mondiale, accroître le PIB mondial de plus de 20 %”, a expliqué M. Bourita.
Dans la sécurité, de même : “les études démontrent une corrélation inverse entre l’égalité de genre et la radicalisation; plus une société est égalitaire, moins elle est exposée aux dérives extrémistes”, a-t-il ajouté.
“Enfin, face au changement climatique, l’évidence est tout aussi forte : alors que les femmes en sont les premières victimes, investir dans l’égalité de genre pourrait permettre de réduire jusqu’à 15 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre d’ici 2050”, a relevé le ministre.
“Parce qu’une diplomatie féministe ne peut se déployer vers l’extérieur sans cohérence intérieure, nous avons fait le choix – dans notre propre appareil diplomatique- d’ouvrir les voies que certains préjugés ou biais avaient obstruées”, a souligné M. Bourita.
“Nous le faisons par une diplomatie du mérite, où la compétence se conjugue au féminin autant qu’au masculin”, a-t-il indiqué.
“A la Centrale, 43% des effectifs du ministère sont des femmes, et 47% des postes de responsabilité centrale leur reviennent. A l’étranger, le tiers de nos postes diplomatiques et consulaires est dirigé par des femmes (45 sur 155, soit 29%, dont 21 ambassades sur 95 et 24 Consulats sur 60). Entre 2004 et 2024, elles sont passées de 3% de Consules générales à 40% – et elles sont souvent parmi les meilleures. Et de 4% à l’échelle du réseau diplomatique, elles sont aujourd’hui 21% d’ambassadrices –à la tête de quelques-unes des Ambassades les plus stratégiques”, a-t-il précisé.
Et de poursuivre: “D’ici-là, il ne s’agit ni de réparer par faveur, ni d’équilibrer par le chiffre ; mais de rendre justice par l’exigence – la même pour tous, adaptée à chacun ; et les femmes n’ont jamais démérité”.
“Si son concept est né au Nord, la diplomatie féministe n’en est pas la propriété pour autant. Comme souvent dans le multilatéralisme, la co-appropriation est la clé de l’universalité”, a fait observer le ministre, ajoutant que cette diplomatie gagne à s’enraciner dans la pluralité des expériences et des trajectoires.
Selon M. Bourita, la force du FFP+ dépendra de sa capacité à écouter et intégrer, à s’élargir sans se diluer, à rassembler sans uniformiser. “En deuxième lieu, la force du réseau ne réside pas seulement dans la noblesse de ses principes, mais dans sa capacité à les traduire en actions concrètes et de les suivre par des mécanismes efficients d’évaluation et de redevabilité. Pour que la diplomatie féministe soit une force de transformation, elle doit s’évaluer, se corriger et, au fur et à mesure, faire ses preuves dans les faits”, a-t-il enchaîné.
Troisièmement, “le FFP+ gagne à renforcer son articulation avec les grandes questions globales. Parce que l’égalité n’est pas un objectif isolé, le FFP+ doit consolider ses ancrages et multiplier ses alliances avec d’autres cadres internationaux, pour incarne la nature transversale de la Diplomatie féministe – qui ne se limite pas à un champ revendicatif, mais irrigue l’ensemble des politiques globales”, a-t-il ajouté.
Dans ce sens, le ministre a suggéré de mettre en place un programme de formation conjointe, porté par le FFP+, consacré à la diplomatie féministe et à la mise en œuvre de l’Agenda “Femmes, Paix et Sécurité”, et de créer des espaces concrets d’échange et de collaboration entre femmes diplomates de toutes régions, pour renforcer ensemble un Agenda global Femmes, Paix, Développement et Droits.
Parmi les propositions également, “favoriser des partenariats bilatéraux et triangulaires entre membres du réseau FFP+, afin de permettre l’échange de bonnes pratiques et de transformer nos convergences en projets de terrain (médiation, climat, égalité d’accès aux fonctions internationales)”, a noté le ministre avant de conclure que “la diplomatie féministe n’est pas un modèle à exporter, mais une expérience à partager”.
La 4e Conférence ministérielle des diplomaties féministes, qui s’inscrit dans la continuité des précédentes conférences organisées par l’Allemagne (2022), les Pays-Bas (2023) et le Mexique (2024), rassemble près de 450 participants, dont une cinquantaine d’Etats invités au niveau des ministres des Affaires étrangères, ainsi que des représentants d’organisations internationales, de banques publiques de développement, de la société civile et de fondations philanthropiques.
Elle sera “l’opportunité pour les Etats et leurs partenaires de réaffirmer collectivement leur attachement aux cadres internationaux en matière de droits des femmes, d’égalité et de justice, et de refuser toute régression”, précise le Quai d’Orsay dans un communiqué.

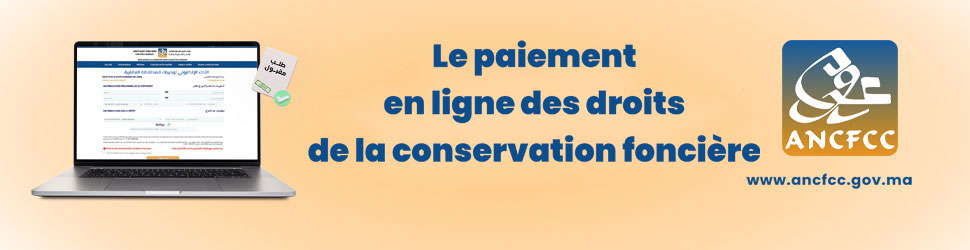
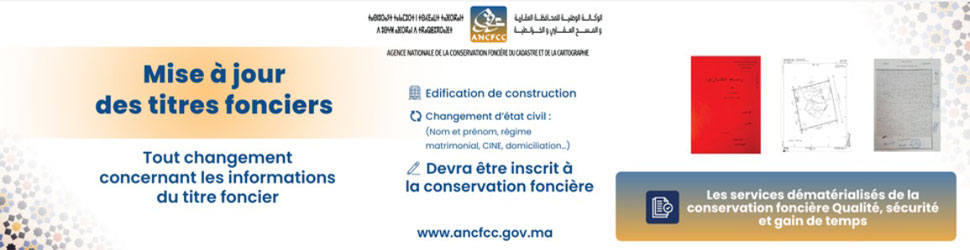




Les commentaires sont fermés.